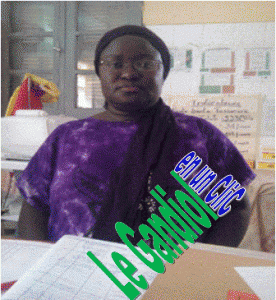
Entretien avec Mademoiselle Isabelle Dominique Coly, sage femme d’Etat, responsable du poste de santé de Tassinère
 « Au niveau du Gandiol, c’est surtout l’hypertension artérielle et les infections respiratoires aigues qui sont les maladies les plus fréquentes ».
« Au niveau du Gandiol, c’est surtout l’hypertension artérielle et les infections respiratoires aigues qui sont les maladies les plus fréquentes ».
L’huitre connait une activité quasi fébrile à Gandiol. Dans cette communauté rurale forte de 29 villages avec une superficie de 600 km², l’exploitation de ce produit du fleuve rythme le quotidien d’une masse de femmes. Cela est à mettre en corrélation avec l’inoccupation de certaines d’entre elles en dehors des tâches ménagères. L’autre facteur pouvant incliner ces dernières à travailler dans ce domaine est que la population de la communauté rurale (avoisinant les 15095 habitants), est concentrée dans la zone côtière. Il n’y a pas motif à se soucier à, en croire la responsable du poste de santé de Tassinère : « Les fruits de mer ont un effet assez toxique sur l’organisme de la personne. Ça, c’est assez universel. Mais quand l’utilisation est faite avec modération, je ne pense pas que ça a un effet ». Selon Mademoiselle Isabelle Dominique Coly, au début, quand la population a commencé à s’adonner à cette activité, il s’est signalé des intoxications alimentaires vite jugulées par une forte sensibilisation des agents des Eaux et Forêts.
Par contre, la sage femme d’Etat est catégorique quant aux maladies les plus fréquentes dans la communauté rurale de Ndiébène Gandiole. Il s’agit de l’hypertension artérielle et des infections respiratoires aigues. Toutes deux s’expliquent par l’environnement. La plupart des repas –pour ne pas dire tous- font appel au sel et à l’huile, sans compte le fait que les femmes travaillent dans l’exploitation de cet « or blanc » à Tassinère. Elles y exposent alors les extrémités de leurs doigts et le sel les pénètre par voie cutanée.
Le Gandiol est aussi riche du fleuve Sénégal et de l’océan atlantique. Tous deux sont à l’origine du vent fort qui souffle sur la zone. Cela peut être à l’origine d’infections respiratoires aigues.
Au sujet de la couverture médicale universelle, Mademoiselle Coly tient à savoir : « On est en train de démarcher la dessus, parce que, cette couverture implique nécessairement la création de mutuelles, donc, une forme de mutualisation autour des postes de santé ». Néanmoins, tout n’est pas du ressort de la responsable du poste de santé de Tassinère : « Ça ne dépend pas carrément de nous, ça dépend des autorités locales ».
S’il y a des avancées majeures, c’est à propos de la vaccination. Des progrès énormes ont été enregistrés, succès qu’Isabelle Dominique Coly met sur le compte de la maturité de la population. « Ce sont des gens qui aiment bien venir se faire vacciner », dit-elle d’un air satisfaite. Tous les deux à trois mois, la sage femme se déplace, nous fait-elle savoir, dans les villages les plus reculés pour une vaccination sur place. « Le taux de décès pour les maladies juvéniles est bas, il n’y a pas de chiffres, mais on le sent », avance t- elle.
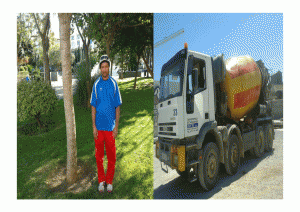
 Lorsqu’il partait à la conquête du destin, Abdel était encore très jeune. Après plusieurs années passées dans le commerce – mais, il a d’abord employé ses forces dans les travaux champêtres-, cet étonnant aventurier se rendit compte que l’horizon se fermait de plus en plus à lui. C’est alors qu’il décida, en 1998, avec l’impérieuse furie de réussir, de prendre congé de son Gandiol natal … vers une destination ….
Lorsqu’il partait à la conquête du destin, Abdel était encore très jeune. Après plusieurs années passées dans le commerce – mais, il a d’abord employé ses forces dans les travaux champêtres-, cet étonnant aventurier se rendit compte que l’horizon se fermait de plus en plus à lui. C’est alors qu’il décida, en 1998, avec l’impérieuse furie de réussir, de prendre congé de son Gandiol natal … vers une destination ….





